pron
who,
prép + whom;
(chose, animal) which, that;
(interrogatif indirect: sujet)
¨ je me demande qui est là? I wonder who is there?;
(: object):
¨ elle ne sait à qui se plaindre she doesn’t know who to complain to ou to whom to complain;
¨ qu’est-ce qui est sur la table? what is on the table?;
¨ à qui est ce sac? whose bag is this?;
¨ à qui parlais-tu? who were you talking to?, to whom were you talking?;
¨ chez qui allez-vous? whose house are you going to?
¨ amenez qui vous voulez bring who(ever) you like;
¨ qui est-ce qui ...? who?;
¨ qui est-ce que ...? who?; whom?;
¨ qui que ce soit whoever it may be.
I.
A.
1. [Dans une interr. dir.]
a) [Suj.] Qui m'appelle, s'écria une voix sèche et furieuse, qui m'appelle? (BARRÈS, Colline insp., 1913, p. 257).
b) [Attribut] Qui es-tu? demanda-t-il (BALZAC, Annette, t. 4, 1824, p. 149).
c) [Régime dir.] Qui aimes-tu le mieux, homme énigmatique, dis? ton père, ta mère, ta sœur ou ton frère? (BAUDEL., Poèmes prose, 1867, p. 11). Qui as-tu choisi? (GIRAUDOUX, Sodome, 1943, I, 4, p. 84).
d) [Régime prép.] Mais à qui devons-nous ces bienfaits! À qui messieurs? (CLAUDEL, Pain dur, 1918, I, 1, p. 412). Tu le sais. Tu bredouilles. Par qui? (GIRAUDOUX, Lucrèce, 1944, I, 1, p. 15).
Rem. 1. Dans qui est-ce qui, le 1er qui a valeur interr., le second introd. une sub. rel. Le premier qui, sans antécédent, exprime le genre animé; le second, en empl. évocateur, marque uniquement la fonction suj. 2. La forme pop. qui que (qui que tu vois?) est à rapprocher decombien que, où que, etc. Le morph. interr. est isolé en tête de phrase par une sub. rel. introd. par un que tendant vers le rel. universel: Et les wagons à vaches, pour qui que c'est? (VERCEL, Cap. Conan, 1934, p. 194). Les autres tournures du lang. pop. sont des var. de la loc. qui est-ce qui: Qui c'est qui va nous le payer? (CÉLINE, Voyage, 1932, p. 494).
2. [Dans une interr. indir.]
a) [Suj.] Et finalement on ne sait pas qui départagera les parties(PROUST, Temps retr., 1922, p. 692).
b) [Attribut] J'ai oublié qui je suis. Je me rappelle qui tu es(GIRAUDOUX, Sodome, 1943, II, 8, p. 157).
c) [Régime dir.] Gélis se lève et se rassied; je sais bien ce qui l'occupe et qui il attend (A. FRANCE, Bonnard, 1881, p. 313).
Rem. En interr. indir., qui est remplacé qqf. dans la lang. parlée parcelui qui: Alors, dites-nous celui qui a le plus de chance? (GUITRY,Veilleur, 1911, I, p. 4).
d) [Régime prép.] Madame Mathias, la vieille bonne, ne savait à qui entendre (A. FRANCE, Pt Pierre, 1918, p. 6). Ma décision était prise d'emmener l'enfant (...) encore que je ne me fusse pas nettement demandé ce que je ferais d'elle par la suite, ni à qui je la confierais (GIDE, Symph. pastor., 1919, p. 879).
B.
1. Pron. rel.
a) [Suj.] Si lugubre que fût l'appartement, c'était un paradis pour qui revenait du lycée (GIDE, Si le grain, 1924, p. 419).
Rem. Dans jouer à qui, un dém. peut précéder le rel.: Nul d'entre eux n'est encore assez intelligent pour jouer à celui qui obéit(DUHAMEL, Plais. et jeux, 1922, p. 58).
1. Pour livrer sa pensée au vent de la parole,
S'il faut avoir perdu quelque peu la raison,
Qui donne son secret est plus tendre que folle...
DESB.-VALM., Élégies, 1859, p. 66.
c) [Régime dir.] Je trouble qui je veux (VALÉRY, Variété III, 1936, p. 129).
d) [Régime prép.] Elle était libre de coucher avec qui elle voulait(MALRAUX, Cond. hum., 1933, p. 215).
Rem. L'effet de sens oscille entre l'indéfinition où qui signifie « n'importe qui » et l'indéterm. feinte, qui suggérant alors une pluralité indéterm. ou désignant une pers. déterminée seulement pour le locuteur.
2. Pron. indéf.
a) Qui que ce soit/fût, loc. pronom. indéf.
b) Rare, littér. Qui que, loc. pronom. concess. Qui qu'elle fréquentât, désormais elle resterait pour tout le monde duchesse de Guermantes (PROUST, Fugit., 1922, p. 669).
c) [Dans la loc. pronom. indéf. n'importe qui] V. importer1 III B etquoi III D ex. de Gide.
C.
2. Depuis lors, à chaque seconde, je suis à l'intérieur d'elle,
animé d'un centuple besoin de la protéger, tout tendu vers un unique objet: qu'à aucun prix elle ne souffre! Protéger Z..., ne rien retirer de ce que j'ai donné à Anne,
être le lien où elles se rencontrent, le seul lien en qui elles se puissent rencontrer...
DU BOS, Journal, 1924, p. 152.
D.
1. [En fonction de suj. ou de régime] Et aux moujiks accourus, il distribuait à qui une jambe, à qui un bras (HANRY, Conquête de Jérusalem, p. 159 ds NYROP t. 5 1925, p. 323):
3. La nuit tombée, il n'était pas rare de voir les sentinelles entrer dans nos baraques et tirer de leur vaste manteau de guérite, qui un poulet, qui un lapin, qui un jambon, en les faisant valoir aux amateurs.
AMBRIÈRE, Gdes vac., 1946, p. 317.
Rem. 1.À qui mieux mieux n'exprime pas toujours le rapport entre deux ou plusieurs pers.; il se peut que ,,l'idée de concurrence évoque celle de l'effort`` (SANDF. t. 2 1965, § 56), de sorte que le tour vient à signifier « de toutes ses forces »: L'enfant se débattait et ruait à qui mieux mieux de ses petits pieds rouges (BENOIT, Axelle, 1928, p. 143, ibid.). 2. À l'aide de la prép. à, on peut former d'autres expr., analogues à l'expr. à qui mieux mieux: À ce point qu'entre les ministres c'est la lutte continuelle à qui ne l'aura pas (COURTELINE,Ronds-de-cuir, 1893, 1er tabl., 1, p. 24).
II.
III.
A.
Rem. 1. Dans les tours faire celui qui, jouer celui qui, le verbe de la sub. peut être au sing. même si le suj. de la princ. est au plur.: Ils faisaient celui qui ne comprend pas (MILLE, Barnavaux, 1908, pp. 155-156). 2. Celui qui peut être repris par le pron. pers. il: Celui qui gueulera le plus fort, il aura la médaille et la dragée du bon Jésus!(CÉLINE, Voyage, 1932, p. 14).
B.
C.
Rem. 1. Accord du verbe dépendant de qui. a) Un verbe ayant le pron. qui pour suj. s'accorde en personne et en nombre avec l'antécédent de celui-ci: Il n'y a que moi, moi qui hais, moi qui aime(SARTRE, Nausée, 1938, p. 189). b) Lorsque qui a pour antécédent un attribut se rapportant à un pron. pers. de la 1re ou de la 2e pers., l'accord se fait avec le suj.; mais il peut se faire aussi avec l'attribut, partic. quand celui-ci est déterminé par un art. déf.: Vous êtes les artisans qui ont construit cette maison (Gramm. Lar. 1964, p. 384), un adj. dém.: Vous êtes ce Monsieur qui m'a porté secours(ibid.) ou lorsque la princ. est nég. ou interr.: Êtes-vous un journaliste qui soit débrouillard? (ibid.). c) Après c'est moi, toi ... qui ou il n'y a que moi, toi ... qui, l'accord peut se faire à la 3e pers. dans la lang. pop.: La bonne: C'est moi qui l'a dit à Madame (Tr. BERNARD, M. Codomat, 1907, I, 2, p. 140). C'est moi qui fait tout! (CÉLINE, Mort à crédit, 1936, p. 490). d) Après un(e) des, un(e) de, l'accord se fait gén. au plur.: Dans un des bâtiments qui flanquaient la forteresse(GRACQ, Syrtes, 1951, p. 26). 2. Place de l'antécédent. a) En règle gén., qui est précédé immédiatement de son antécédent: Des locataires, qui étaient tous des amis (PROUST, Sodome, 1922, p. 1057). b) Qui peut être séparé de son antécédent lorsque celui-ci est un pron. compl. d'un verbe de perception ou d'un présentatif: Je le vois qui traverse le jardin (CÉLINE, op. cit., p. 465). La voici qui danse pour nous (MAURIAC, Journal 2, 1937, p. 198). c) Lorsqu'il est séparé de son antécédent par les conj. de coord. et/ou: Cette longue bataille qu'Antoine, en lui-même, continuait à appeler « les attaques de Provins », et qui était pour tous la bataille de la Marne (MARTIN DU G., Thib., Épil., 1940, p. 832). d) Parfois, l'antécédent peut être placé après la prop. rel.: Elle me montra, qui jouait, dans son jardin, un de ces ânes charmants de Provence, aux longs yeux résignés (BARRÈS, Jard. Bérén., 1891, p. 49). e) En règle gén., qui peut être séparé de son antécédent par un compl., une prop., etc., lorsque l'intelligence du texte n'en souffre pas: Son visage creusé, sa silhouette émaciée, ses prunelles souffrantes étaient là qui me bouleversaient (BOURGET, Disciple, 1889, p. 188). Les fascistes ne voyaient son corps que jusqu'au ventre, et tiraient à qui mieux mieux sur ce buste incroyable en veston d'alpaga, en cravate rouge, qui lançait une charge de dynamite avec un geste de discobole, du coton dans les oreilles (MALRAUX, Espoir, 1937, p. 540). 3. [Avec un verbe impers., il y a parfois une hésitation entre qu'ilet qui] Le peu d'argent qui lui restait après l'acquisition de la barque avait été employé à acheter un petit télescope de rencontre(STENDHAL, Chartreuse, 1839, p. 25). Maintenant qu'il n'avait plus de doute sur ce qu'il lui restait à faire, il semblait fatigué, mais très calme (ROLLAND, J.-Chr., Antoinette, 1908, p. 851).
Prononc. et Orth.: [ki]. Att. ds Ac. dep. 1694. Étymol. et Hist. I.Pron. rel. A. En fonction de suj. 1. empl. avec antécédent 842 masc. sing. (Serments de Strasbourg ds HENRY Chrestomathie, 1, 7: Et ab Ludher num plaid nunqua'm prindrai qui, meon vol, cist meon fradre Karle in damno sit); ca 881 id. (Ste Eulalie, ibid., 2, 6; 12); fin Xe s. fém. sing. (Passion, éd. D'Arco Silvio Avalle, 268); ca 1050 masc. plur. (St Alexis, éd. Chr. Storey, 263); spéc. apr. un indéf., un dém. 2emoit. Xe s. ici, la régissante est nég., le verbe de la rel. est au subj. (St Léger, éd. J. Linskill, 32: Ne fud nuls om ... Qui mieldre fust); 2. empl. sans antécédent a) désigne une pers. partic., déterm. 2e moit. Xe s. (St Léger, 26: Et cum il l'aut doit de ciel'art [Deu servir] Rende'l qui lui lo comandat); b) désigne une pers. indéterm., avec valeur gén., la rel. pouvant prendre un tour sentencieux
Cour. [Empl. seul ou précédé d'un pron., d'un adj. ou d'un adv. interr.] Introduit une interrogation directe qui conserve l'ordre des mots de la phrase énonciative.
A.
Est-ce que j'ai peur de la mort?
Parce que je suis une fille est-ce qu'il croit que je ne suis pas capable de le servir et de mourir pour lui?
CLAUDEL, Soulier, 1929, 4e journée, 3, p. 869.
1. [Le mot interrogatif peut être :]
a) [un pronom]
Rem. Le pron. interr. peut être construit indirectement. De quoi est-ce que j'aurai l'air? (MONTHERL., Ville dont prince, 1951, II, 4, p. 893). Par lequel est-ce qu'on commence? (GREV. 1969, loc. cit.).
b) [un adj. déterminant un nom de chose, plus rarement de pers.] Quel rapport est-ce que tout cela avait avec sa propre histoire? (ARAGON, Beaux quart., 1936, p. 303).
c) [un adv.] Comment, pourquoi est-ce que... Quand est-ce que je te revois, puisque tu es collé dimanche?(MONTHERL., Lépreuses, 1939 p. 899).
2. [L'interrogation porte :]
a) [sur le suj. (l'élément terminal du morph. est qui)] Qu'est-ce qui, pour toi, passe avant tout le reste? (GIDE,Journal, 1943, p. 200). Cf. aussi CAMUS loc. cit. et supra CLAUDEL, Poète regarde Croix, 1938, p. 189).
b) [sur un autre élément de la phrase (l'élément terminal du morph. est que)] Qu'est-ce que... tu comptes faire, toi?(MARTIN DU G., Thib., Été 14, 1936, p. 537). Cf. aussi supra ARAGON, Beaux quart., 1936, p. 303 et MONTHERL., Ville dont prince, 1951, II, 4, p. 893, 899.
Rem. 1. L'usage du morph. interr. est-ce que s'est répandu, surtout dans la langue orale; il permet en effet de conserver l'ordre normal de la phrase énonciative : suj. + verbe. 2. La langue populaire abrège volontiers est-ce queen s'que, c'que : Ousqu'il court donc, l'Arthur? (G. CHEVALLIER, Clochemerle, XVIII, 192 ds R. LE BIDOIS, L'Invers. du suj. dans la prose contemp., Paris, D'Artrey, 1952, p. 63), ou même en que : Comment que votre frère a fait?(GOUG. Syst. gramm. 1962, p. 276). 3. La lang. fam. renforce parfois est-ce que par c'est que ou c'est qui. Qu'est-ce que c'est que celui-là? Un jaune? (ARAGON, Beaux quart., 1936, p. 502).
Prononc. : [
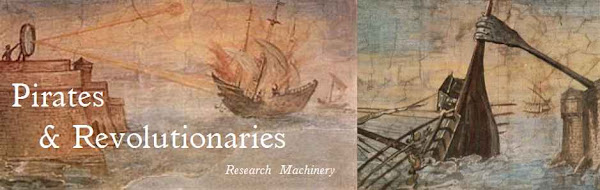










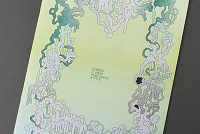


































No comments:
Post a Comment