[Search Blog Here. Index tabs are found at the bottom of the left column.]
[Central Entry Directory]
[Logic and Semantics, entry directory]
[Brice Parain, entry directory]
[Parain, Recherches sur la nature et les fonctions du langage, entry directory]
Le paysan qui arrache ses pommes de terre, s’il aperçoit au fond du trou qu’il creuse, tandis que son | crochet est levé, un reflet d’une couleur insolite, dévie aussitôt l’élan de son outil pour épargner cet endroit qui l’étonne. Il n’a pas besoin, semble-t-il, de raisonner pour cela. Les chats ont de telles adresses et de tels redressements lorsqu’ils jouent et plus encore lorsqu’ils se battent. On dirait qu’alors l’impression visuelle a provoqué immédiatement la réponse du geste, et que l’image du danger a engendré spontanément l’image de la parade, sans que rien d’autre ait pu intervenir entre elles, tant le mouvement a été rapide et naturel.(26-27)
Revenons à notre paysan. Il s’écrie soudain : « Tiens ! », ou encore : « Tiens ! Un ver blanc ! ». S’il n’avait eu besoin que de détruire la larve, il l’aurait fait, probablement, sans une parole, comme à l’instant pour la pomme de terre cachée, tout au plus en poussant une exclamation qui n’aurait eu d’autre sens que d’exhaler sa surprise, ou de marquer un temps de son travail. Mais la présence du ver blanc est chose grave; elle prédit des hannetons pour l’année prochaine. Cette menace, le paysan la voit en voyant la bête. L’image du ver blanc appelle en lui l’image du hanneton. Et comme il n’y peut rien tout de suite, il réserve l’événement pour y faire face autrement que par un coup de son crochet. Et nommant le ver blanc, il aide sa mémoire qui conserverait moins fidèlement une image non nommée. Surtout il attribue à cette image une existence particulière, il lui donne une consistance qu’elle n’a pas de nature, il la transforme en un objet de réflexion et de raisonnement, il la détache du devenir pour la poser dans le cycle de la connaissance. Voilà ce dont il paraît bien que les animaux soient incapables, et en même temps la première distinction que nous puissions établir entre eux et nous.(33)
A première vue, donc, notre activité humaine est | double. Tantôt elle parcourt d’un mouvement qui paraît continu un circuit qui semble se refermer naturellement sur lui-même, et qui est jalonné par l’impression initiale, la proposition d’images qu’elle provoque, et l’action qui lui répond. Tantôt elle introduit dans ce cycle un nouvel élément qui est le langage, et qui l’ouvre, autant dire, sur l’infini. Car il n’y a jamais de conclusion définitive à aucun raisonnement ; l’oubli n’a pas de prise sur les mots, de paroles ils deviennent des formules écrites, de formules des livres et les livres se répondent les uns aux autres comme en un dialogue qui n’est jamais achevé.(33-34)
Pourtant avons-nous le droit d’affirmer qu’il y ait une telle différence de nature entre ces deux formes de notre activité ? Il se pourrait, au contraire, que le langage pénétrât jusque dans la forme qui nous apparaît comme la plus animale et que notre nostalgie du silence ne fût qu’un rêve analogue à celui qui fit naître le mythe de l’âge d’or ou celui de l’état de nature, c’est-à- dire encore un phénomène littéraire.(34)
Si le paysan, dans le premier exemple, ne dit rien, c’est qu’il sait, autant qu’il a besoin de le savoir, quelle conduite il doit tenir. Ainsi nous comportons-nous en face de tout événement habituel. Mais l’étonnement déclenche toujours une réflexion où le langage intervient. L’enfant ponctue toutes ses premières surprises d’une exclamation, qui n’est pas un simple cri mais un essai de dénomination. Imaginons, pour un instant, ce que serait le monde extérieur si nous n’avions pas le langage. Quand nous voyons une mouche qui, obstinément, revient se cogner contre la même vitre, nous pensons qu’elle est sotte ; mais si nous y réfléchissons, nous comprenons bien vite que chez elle, la sensation demeure, vraisemblablement, à l’état fruste, comparée à la nôtre, et que la mouche, de ces coups qu’elle reçoit, puis qu’elle ira jusqu’à en être étourdie, ne conclut rien d’autre que nous lorsqu’en rêve nous nous débattons contre un poids qui nous oppresse, incapables de lui donner un nom, subissant, sans y rien pouvoir, le cauchemar qu’il provoque en nous. Quelle est donc cette porte contre laquelle je me heurte dans l’obscurité | sinon la douleur de mon front et la route barrée à mon passage ? Dès que je ferme les yeux je perds le sentiment de ma personnalité, et je tombe dans un état d’appartenance où les frontières s’effacent entre le monde et moi. Il faut alors que je me reprenne, pour distinguer le bruit qui m’entoure du mouvement de ma propre vie. Et même lors que mes yeux sont ouverts devant moi, aux moments où je ne regarde pas, je ne saurais dire si l’horizon est une ligne brumeuse au loin ou l’attente de mon esprit.(p.34-35)
L’insecte, sans doute, se meut dans son univers d’actions et de réactions sans se représenter le monde extérieur comme un objet indépendant de cet univers, qui reste ainsi homogène. Ne serions-nous pas dans la même ignorance si nous n’avions pas le langage ? Je remarque que l’enfant forme son idée du monde extérieur pendant le temps qu’il apprend à parler. Je note la netteté avec laquelle l’objet se détache de moi dès que je l’ai nommé. A partir de cet instant je ne peux plus lui refuser d’être un objet. Les philosophes ont bien observé que toute perception se constitue par un jugement. Mais ont-ils suffisamment souligné que c’est la dénomination qui est le premier jugement, et qu’elle est le moment décisif de la perception ?(35)
Lorsque, ressentant certains troubles internes, je déclare que j’ai faim, je ne communique pas mes sensations aux personnes à qui je m’adresse, je leur signifie seulement que j’ai le désir de manger, ou plutôt encore que je crois que j’ai besoin de manger. J’ai pensé, en effet, que mon malaise serait calmé si j’absorbais quelque nourriture. Ce faisant, j’ai avancé une hypothèse touchant mon état. Mais je peux me tromper. Les mutilés ont bien froid à la jambe qui leur a été coupée. Un docteur n’accepterait pas nécessairement mon diagnostic. Chaque mot que je prononce n’est qu’une vibration de ma voix, un flatus vocis, pour qui refuse de lui attribuer le même contenu que moi. C’est donc que ce contenu ne lui est pas nécessairement attaché, c’est donc que je ne l’y dépose pas en le prononçant. Mon médecin ne m’interroge même pas, il m’ausculte.(35)
Blaise Pascal nous a laissé une règle que nous consi- | dérons, à bon droit, non seulement comme la règle fondamentale de tout raisonnement géométrique, mais aussi comme la règle d’or de tout raisonnement et de tout discours. Elle consiste à « substituer mentalement la définition à la place du dé fini » et à « avoir toujours la définition si présente que toutes les fois qu’on parle, par exemple, du nombre pair, on entende précisément que c’est celui qui est divisible en deux parties égales, et que les choses soient tellement jointes et inséparables dans la pensée, qu’aussitôt que le discours en exprime une, l’esprit y attache immédiatement l’autre. Car les géomètres et tous ceux qui agissent méthodiquement n’imposent de noms aux choses que pour abréger le discours et non pour diminuer ou changer l’idée des choses dont ils discourent 1 ». Mais cette règle, qui paraît si simple à l’énoncé qu’il suffirait d’un effort de chacun pour que tout e discussion devînt immédiatement féconde, est-elle applicable rigoureusement ?(35-36)1. BI. Pascal, De l’esprit géométrique. J. Hadamard (Leçons de géométrie élém., op. cit., p. 263) place cette règle en tête de son exposé sur la méthode en géométrie.(36)
La véritable définition de mon état que j’appelle faim serait l’ensemble des sensations que j’éprouve, la véritable définition de la faim serait l’ensemble des sensations, et de celles-là seulement, qui seraient apaisées par de la nourriture, et par rien d’autre que de la nourriture. Car, en effet, l’enjeu de l’entreprise est ici mon bien-être. Ma dénomination serait juste dans le cas où ces deux ensembles seraient identiques, et dans ce cas seulement, fausse dans le cas contraire. Mais de telles définitions et une telle équation sont évidemment impossibles à produire. D’où notre embarras dès que nous parlons. Où s’attachent nos paroles ? On compte fort peu de bons géomètres. Pourtant la géométrie est un domaine aux routes bien tracées et bien signalées. C’est qu’elle commence par des définitions et des axiomes, c’est-à-dire par des dénominations, qui ne sont pas claires pour chacun, « convaincantes », dirait Pascal. Puis-je accepter, préalablement à tout, que la ligne soit uniquement « la partie commune à deux portions contiguës d’une surface », la surface « la partie | commune à deux portions contiguës de l’espace », ne sachant pas ce que sont partie, commune, portions, surface, contigu, espace ... etc.? Ou le dois-je ? Et de quelle obligation ? Si, au contraire, je me demande d’abord pourquoi cet objet dont on me parle est appelé ligne? Il me faudrait évidemment, avant toute opération, être assuré que ces formules ont un sens et le même pour tous, c’est-à-dire, que chacun voit le 1nême objet lorsqu’on parle de la ligne. Or, même lorsque j’essaie d’établir pour moi un rapport entre mes sensations et mes paroles, je m’aperçois que c’est un problème insoluble puisqu1il s’agirait de poser une identité entre deux phénomènes de natures diverses. A plus forte raison si j’introduis, en outre, dans ce problème, d’autres facteurs pareillement incertains, à savoir les personnes avec qui j’entre en communication. Aussi ne puis-je m’empêcher de craindre, chaque fois que j’ouvre la bouche, d’être engagé dans une opération infinie, telle que la division de l’unité en la série½ + 1/22 + 1/23 + 1/24 …,les apories de Zénon et surtout le fameux argument du troisième homme m’en fournissent des exemples 1.(36-37)1. Voici un énoncé de cet argument qui nous a été transmis par Alexandre (In Métaph., 990 b. 15, p. 83, Hayduck) : « Si ce qu’on affirme de plusieurs choses à la fois est distinct de ces choses et subsistant par soi, il y aura. l’homme étant affirmé et des individus et de la forme, un troisième homme distinct et des individus et de la forme ; il y en aura de même un quatrième, puis un cinquième et ainsi à l’infini »(cité par M. A. Dies en nota à 132 b du Parménide de Platon, Les Belles Lettres, t. VIII, Ire partie, 1923, p. 63).(37)
Il est donc impossible, théoriquement, que sensations et mots se rejoignent, de même qu’Achille, poursuivant la tortue, ne réussira jamais à l’atteindre. On m’interdit d’additionner des chevaux et des portes. Comment pourrais-je écrire une équation dont le premier terme ne serait pas lui-même une formule ? Cependant telle est bien la démarche par laquelle débute toute pensée discursive. Cette démarche s’appelle la dénomination. | Elle consiste à attribuer un nom à une chose. Elle est la première attribution, celle sur qui tout raisonnement repose, car avant de dire que Socrate est sage, il faut d’abord qu’il soit convenu que cet homme dont il est question a pour nom Socrate. Et la première erreur est d’appeler Socrate un homme qui ne porte pas du tout ce nom.(37-38)
Lorsque j’analyse l’expression « j’ai faim », si je dis que « je » en est le sujet et « ai faim » le prédicat, je ne dois donc pas omettre d’ajouter que « je » c’est moi, à savoir ma personne en chair et en os au moment où elle prononce cette phrase. L’opération réelle n’a pas consisté à réunir « ai faim » comme prédicat au sujet « je », mais à exprimer un état que je perçois et à le nommer : « j’ai faim ». Un enfant dirait sans doute, « faim » tout court ou « manger », car le « je » n’a pas du tout besoin d’être énoncé, puisque c’est lui-même qui énonce.(38)
Voilà, du moins, ce que pense en premier lieu un observateur non prévenu des phénomènes de langage.(38)
« Sous l’influence de la logique formelle, qui, jusqu’au début du XIXe siècle, a dominé toutes les théories grammaticales, par suite aussi de l’habitude de fonder les théories linguistiques sur des formes de la langue écrite, on s’est longtemps imaginé que toute phrase comporte naturellement un « sujet » et un « prédicat », remarquait naguère A. Meillet. La phrase à terme unique apparaissait dès lors comme incomplète : dans une phrase composée du prédicat seul, il y aurait « ellipse » du sujet. Pour qu’il y ait phrase, il faut et il suffit que quelque chose soit énoncé ; ce peut être un fait particulier ou une vérité générale que l’on indique, un sentiment que l’on exprime, un ordre que l’on formule. On peut convenir d’appeler « prédicat » ce qui est ainsi énoncé. Mais il faut retenir que la phrase ainsi définie diffère des « propositions » de la logique formelle, et par suite le terme de « prédicat » n’est pas ambigu. Les conditions où se trouvent les interlocuteurs suffisent souvent à indiquer à quoi s’applique le « prédicat ». La phrase à terme unique est chose normale, et c’est sans doute de là qu’est parti le langage. Les linguistes qui | ont réfléchi sur la théorie de la phrase s’en sont aperçus depuis longtemps 1 ... »(38-39)1. A. Meillet, Linguistique historique et linguistique générale, t. II, Paris, 1936, p. 2. A. Meillet s’efforce de montrer que l’élément premier du langage est non pas le mot mais la phrase. « C’est par la phrase à terme unique, dit-il encore, que les enfants commencent à parler. Du huitième au treizième mois l’enfant ne parle que par mots isolés ou répétés ... La phrase à terme unique est normale pour appeler quelqu’un : Pierre ! maman ! ... Elle est courante pour donner un ordre : feu ! halte ! en avant ! silence! elle est aussi commode pour indiquer une appréciation : bien ! dommage ! fâcheux ! ... etc. Des mots comme oui, non représentent le plus haut degré d’abstraction que puisse atteindre ainsi une réponse consistant en un seul mot. » (Ibid., p. 3-4.)
La première conséquence d’une telle théorie serait de renverser le cogito de Descartes en le présentant comme une proposition triviale, « ergo sum » n’étant plus que l’explication du « je » qui figure dans le o de cogito, indicatif de la première personne du singulier. Je ne peux pas penser sans être, je ne peux pas parler sans penser, ni par conséquent sans postuler mon existence : tout cela est déjà dans le « je » de «je pense », dans le « o » de « cogito ». Écoutons Nietzsche à ce sujet 2 : « Soyons plus prudents, dit-il, que Descartes qui est resté pris au piège des mots. Cogito, à vrai dire, n’est qu’un seul mot, mais le sens en est complexe. (Il ne manque pas de choses complexes que nous empoignons brutalement, croyant de bonne foi qu’elles sont simples.) Dans ce célèbre cogito il y a : 1° quelque chose pense ; 2° je crois que c’est moi qui pense; 3° mais en admettant même que ce deuxième point soit incertain, étant matière de croyance, le premier point : quelque chose pense, contient également une croyance, celle que « penser » est une activité à laquelle il faut imaginer un sujet, quelconque ; et l’ergo sum ne signifie rien de plus. Mais c’est la croyance à la grammaire ; on suppose des « choses » et leurs « activités » et nous voilà bien loin de la certitude immédiate. Faisons donc abstraction de ce « quelque chose » problématique et disons cogitatur, pour constater un état de fait sans y mêler d’articles de foi : nous nous ferons illusion une fois de plus, car même la forme passive contient des articles | de foi outre des « états de fait » ; somme toute, c’est justement l’état de fait que l’on n’arrive pas à présenter tout nu ; les formules cogito, cogitat, cogitatur, contiennent toutes une « croyance » ou une « opinion ». Qui nous garantit que grâce à l’ergo nous n’enlevons pas quelque chose à cette croyance ou à cette opinion, si bien qu’il ne reste plus que ceci : « quelque chose est cru, donc quelque chose est cru », cercle vicieux! Enfin, il faudrait pourtant savoir ce que c’est qu’« être » pour tirer le sum du cogito ; il faudrait de même savoir ce que c’est que savoir : on part de la croyance à la logique, à l’ergo avant tout, et non pas uniquement de la position d’un fait. Dans le savoir, la « certitude » est-elle possible? La certitude immédiate n’est-elle pas peut-être une contradictio in adjecto ? Qu’est-ce que connaître par rapport à être? Pour celui qui apporte sur ces points une croyance toute faite, la prudence cartésienne n’a plus de sens ; elle vient trop tard. Avant d’en venir au problème de l’ « être », il faudrait avoir résolu le problème de la valeur de la logique. »(39-40)2. La Volonté de puissance, éd. F. Würzbach, L. I., Introduction, fragment 98 (trad. G. Bianquis, N.R.F., 1935, t. I, p. 65).(39)
Nietzsche pose parfaitement le problème du langage, en ne croyant poser que celui de la logique. Si le « je » de « je pense » n’est que Descartes en personne ou Nietzsche, ou quiconque énonce cette proposition, le cogito est une duperie philosophique. Il additionne des chevaux et des portes. Il nous présente comme un fait ce qui n’est qu’une opinion. Mais alors ce n’est pas seulement la logique qui est renversée dans son principe, c’est aussi le langage lui-même, qui commet à chaque instant la même faute. Il n’y a plus moyen de rien affirmer, ni même de rien dire, sans se tromper et tromper les autres. Le cogito ne peut avoir de sens que si le postulat sur lequel il repose est vrai, à savoir que l’énoncé pur et simple d’un mot ou d’une phrase implique l’affirmation d’une existence extra-phénoménale de celui qui par le et de celui qui écoute, et introduit l’un et l’autre dans ce que nous appelons le monde intelligible. Descartes n’a pas formulé ce postulat, il l’a seulement préparé en distinguant avec soin notre existence phénoménale qu’il est prêt à traiter de rêve et l’existence essentielle dont il parle. On verra que la discussion | des différents problèmes posés par la nature et les fonctions du langage conduit toujours et nécessairement à l’examen des rapports entre vérité et réalité. Regardons d’abord quelques aspects bien connus mais souvent négligés de nos paroles.(40-41)
Il ne suffit pas pour aimer quelqu’un d’agir selon l’amour, il faut encore le lui dire. Etre entouré d’une tendresse qui ne se déclare pas, être l’objet d’une sollicitude constante n’est pas du tout la même chose que d’avoir reçu la promesse ou l’engagement qu’apporte la parole 1. Ressentir poétiquement et être poète sont deux choses tout à fait distinctes. C’est que nos paroles créent des êtres et qu’elles ne se contentent pas de manifester des sensations. L’exemple du paysan qui arrache ses pommes de terre va nous instruire ici. Il n’est pas sans apercevoir maints détails qu’il ne formulera pas. Il surveille, tout en travaillant, l’état de sa terre, il enregistre dans son corps des impressions qui ne se perdent pas parce qu’elles le transforment au fur et à mesure de leurs apparitions, il voit que la récolte est bonne, que les pommes de terre ne sont pas trop gâtées ni trop mangées, il entend les voix des gens qui jardinent non loin de lui, les voitures qui cahotent dans le chemin, il a chaud si le soleil se montre après un nuage, il v it, il vieillit, il se fatigue, il se | façonne ... puis soudain il s’écrie : « Tiens, un ver blanc! » Son exclamation n’a pas pour but de constater l’existence du ver blanc, comme si celle-ci venait de lui être révélée par son regard. Il ne doute pas de l’existence de toutes les autres choses qui l’entourent et vous 1’étonneriez si vous faisiez une distinction de cette nature entre le ver blanc dont il parle et le soleil dont il ne parle pas, qui pourtant lui fait ouvrir son col de chemise ou enlever son gilet. Ce que son exclamation lui apporte, ce n’est pas une constatation d’existence, mais une affirmation d’existence, ce n’est pas l’indication d’un individu ou d’un événement particulier, mais la signification d’un genre.(41-42)1. « Edmée n’en avait pas moins été jusqu’ici assez peu sûre d’elle- même, sa théorie de la vertu était que les hommes ont un mot, qui leur donne toute femme, quand ils l’emploient à propos. Le mot n’étant généralement pas le même pour chacune, il arrive qu’à la faveur des confusions pas mal de vertus restent intactes, mais tous les accidents arrivés aux amies d’Edmée, à des amies sages, insensibles, lui prouvaient qu’elle avait raison. C’était toujours aux paroles qu’elles avaient dû leur chute, comme on dit, comme elles ne disent pas. Jamais cela n’avait ressemblé au rapt, à la surprise, à la détente, à la brutalité. C’est en tant qu’orateur que l’homme les avait toutes gagnées ... Aucune n’avait cédé à un muet, ou à un silencieux. Parfois le mot était un simple mot, un imparfait pluriel du subjonctif, un de ces noms communs mélangé dans la foule des noms communs, mais qui ont gardé une valeur d’incantation, d’inflexion, un nom géographique. .. Elle avait bien suivi Pierre, qui n’avait dit qu’un mot lointainement parent du vrai mot, parent seulement dans son apparence, d’une parenté qui semblait d’ailleurs chaque jour plus lointaine : je vous aime. Chez les Seeds tous étaient muets. » (J. Giraudoux, Cheix des Élues, chap. v.)(41)
Chaque mot, en effet, dépasse l’individuel et appartient au genre 1, transpose la réalité sensible dans un autre domaine qui lui est propre. Ce dont j’ai la science, ce n’est pas du prunier qui pousse à côté de notre maison, mais du prunier en général et qui n’est ni mon arbre ni aucun arbre enraciné, mais une idée du prunier, le sens du mot prunier. La mort de mon prunier ne détruira pas ma science du prunier, au contraire même est-elle susceptible de l’accroître. Si je dis cet | arbre, ma maison, je signifie seulement que je montre un arbre, que cette maison m’appartient, je signifie un rapport, je ne représente pas l’arbre ou la maison dans leur individualité. Même si je tente de décrire une chose ou de la définir, je parlerai de mon allée de tilleuls ou du frêne fourchu qui ferme la pointe de la prairie, mais celui qui n’aura pas vu mon allée de tilleuls ou le frêne dont il est question ne les imaginera pas tels qu’ils sont, rien qu’à m’écouter ou à m e lire, celui qui les aura vus préférera pour les évoquer leur image à mes paroles, et celui qui se contentera de mes paroles au lieu de les aller voir, c’est parce que ce ne sont pas le frêne ou les tilleuls qui l’intéressent, mais ce que mes paroles lui disent. Si je veux reconnaître quelqu’un, je lui donne un nom, mais ce nom n’est pas lui. Il le sait bien et me reproche amèrement de le trahir lorsque je le traite comme un nom et non comme sa personne. Madec a été tué, il est mort et son nom lui survit mais il n’est que mon souvenir de lui, celui de sa mère et de sa sœur, comme il n’a jamais été que notre pensée de lui. Même le « je » de « j’ai faim », alors que c’est moi qui le prononce, et que mes interlocuteurs me voient, m’entendent, complètent ce que mes paroles expriment à l’aide de toutes les autres impressions que leur apportent leurs sens, même dans ce cas qui paraît le plus proche de la communication directe, ce n’est pas moi que le « je » exprime, mais une figure de moi, ma pensée de moi, ou, pour reprendre les termes de Spinoza, une détermination de moi 1.(42-43)1. On rapprochera les remarques qui suivent des arguments dont se servaient les Platoniciens, d’après Aristote et Alexandre, pour démontrer l’existence des Idées. « Si toute science, disaient-ils, en accomplissant son œuvre propre, la rapporte à un objet un et identique, et non à tel ou tel objet particulier – le raisonnement géométrique, par exemple, à l’essence du triangle et non à tel triangle tracé en particulier –, il faut que, en dehors des choses sensibles, il y ait quelque chose de distinct, qui soit éternel et serve de modèle aux objets que, dans chaque cas particulier, se proposent les sciences; ce quelque chose, c’est Idée. En outre ce qui est objet de science existe; or les sciences portent sur un objet qui est distinct des choses particulières ; celles-ci en effet, sont en nombre infini et indéterminées : l’objet de la science, c’est au contraire le déterminé. Il y a des réalités séparées des choses particulières: ce sont les Idées. Enfin, si la médecine n’est pas la science de telle ou telle santé mais de la santé prise absolument, il faut qu’il y ait une santé en soi: de même si la géométrie n’est pas la science de tel ou tel cas d’égalité ou de commensurabilité, mais de l’égal ou du commensurable pris absolument, il faut qu’il y ait un égal en soi et un commensurable en soi : or ce sont précisément les Idées. » (Commentaire d’Alexandre à Aristote, Métaphysique, A 990 b. 1-17 (apud Léon Robin : La Théorie platonicienne des Idées et des Nombres, Paris, 1908, chap. 1, § 2). Pour le rapport entre εἴδη et λόγοι, cf. B. Parain Essai sur le logos platonicien, Paris, p. 52 sqq.(42, first footnote 1 above)1. Lettre 50, à J. Jelles, éd. Van Vloten, t. II, p. 361 : figura non aliud quam determinatio. Spinoza ajoute : et determinatio negatio est, formule que nous examinerons à l’instant.(43, second footnote 1 above)
On dit que notre langage découpe arbitrairement des objets dans la réalité mouvante. On le dit comme si nous en étions coupables. Et en effet nous éprouvons toujours le tourment d’une inadéquation de nos paroles et de ce que nous les chargeons d’exprimer, nous ne cessons de nous reprocher les méfaits de cette inexactitude. Determinatio negatio est. Tout ce que nos paroles laissent échapper de cette réalité mouvante est sacrifié, semble-t-il, ou du moins n’est pas représenté alors | qu’il le devrait être. J’ai faim, mais cette faim ne me figure pas tout entier. Il court, mais il ne fait pas que courir, il pense à ses affaires, il a peur ou il est exalté, et peut-être même ressent-il l’infini dans cette course qui n’en finit pas et dont il ne connaît pas le but, car il sera peut-être arrêté par une chute, une balle, ou un spasme de son cœur. Mais il ne nous est pas donné d’agir autrement. Autant qu’une déformation, nos paroles sont une formation, autant qu’une négation de quelque chose, elles sont affirmation d’autre chose, qui est peut-être le plus important, qui est peut-être l’essentiel. Essence est dans essentiel. La lumière, la tristesse, le vent existeraient-ils sans les mots de notre langage? N’y aurait-il pas, à leur place, que des vibrations, des chocs d’atomes, des moments indétachables de ma durée, des nuages fuyant sous le ciel, des arbres gémissants, un souffle de l’air, disparus aussitôt qu’apparus, n’apparaissant pas même?Quand tu sauras mon crime et le sort qui m’accable,Je n’en mourrai pas moins, j’en mourrai plus coupable 1.« Il devenait fou; il lui sembla qu’en se penchant ils se donnaient des baisers, là, sous ses yeux. Cela est impossible en ma présence, se dit-il ; ma raison s’égare. Il fa ut se calmer; si j’ai des manières rudes, la duchesse est capable, par simple pique de vanité, de le suivre à Belgirate ; et là, ou pendant le voyage, le hasard peut amener un mot qui donnera un nom à ce qu’ils sentent l’un pour l’autre ; et après, en un instant, toutes les conséquences 2. »(43-44)1. Phèdre, acte I, scène II.2. Stendhal , La Chartreuse de Parme, Ire partie, chap. VII (Bibl. de la Pléiade, p. 153). Le comte Mosca est jaloux, il craint que la duchesse Sanseverina « fasse amour » avec Fabrice, mais il n’en est pas sûr, et il est assez fin pour éviter toute maladresse qui provoquerait l’irréparable. La déclaration qui « cristalliserait » les sentiments que la duchesse et Fabrice ont l’un pour l’autre et les transformerait en une liaison, Stendhal y verrait volontiers un effet du « hasard ». Toute la question est là. Elle a été soulevée par Pascal. C’est celle du rapport entre nos paroles, l’univers et nous-mêmes. Du moins Stendhal nie-t-il que la passion puisse en être la seule cause.(44)
Les théologues d’Héliopolis avaient fort bien discerné que « nulle chose n’existe avant que d’être nommée 1 ». L’Orient sémitique nous apparaît comme illuminé par ce principe de la naissance des choses : « Dieu des pères, Seigneur de miséricorde, qui avez fait l’univers par votre parole ... » (ὁ ποιήσα τὰ πὰντ ἐν λογοίς σου), enseigne le Livre de la Sagesse 2. Une prière du matin dans la synagogue commence par une adresse à Dieu qui prolonge jusqu’à nos jours l’écho des premiers versets de la Genèse : « Béni sois -tu qui parlas ct le monde fut 3. » Et nous-mêmes, qui avons hérité de cette tradition par le IVe évangile, nous disons encore, parlant d’un personnage dont nous voulons proclamer la puissance : « il n’a qu’un mot à dire », comme si cet homme n’était pas puissant par son art de faire exécuter ses ordres, mais parce que ses paroles, d’elles-mêmes, | deviendraient des actes 1. Les paysans de mon pays, lorsqu’ils citent un dicton qui prédit le temps, ne disent pas : « c’est vrai », mais « cela y fait ». « La pluie du matin n’arrête pas le pèlerin, cela y fait. » Et comment pourrait-il en être autrement? Le paysan, l’ouvrier parleraient-ils avec cette assurance de désigner des choses réelles, et de ne faire qu’un avec le monde où ils travaillent, aurions-nous jamais lu et étudié, si nous n’avions pas été convaincus avant d’y avoir réfléchi, si nous ne restions pas persuadés contre toute réflexion, qu’en énonçant le mot « route », c’est la route elle-même, en pierres et en sable, que nous proférons, qu’à chacune de nos paroles nous disons quelque chose (τι λέγειν). C’est une opinion du sens commun, mais c’est aussi le postulat de la philosophie cartésienne. « Ordo et connexio idearum idem est ac ordo et connexio rerum 2. » Le rôle du discours est de représenter fidèlement le cours des choses. Autrement il n’est pas de langage possible. La seule différence est que l’artisan croit que les mots signifient des objets, et encore peut-être pense-t-il plutôt, comme Platon, qu’ils signifient des modèles, alors que le philosophe croit qu’ils figurent l’essence des choses. Mais tous deux admettent confusément qu’à l’origine mots et choses n’ont été que deux aspects correspondants d’une même pensée divine créatrice, et qu’ils sont étroitement liés par un rapport mystérieux mais incontestable.(45-46)1. A. Moret, Le Nil et la civilisation égyptienne, Paris, 2e éd., 1926, p. 437. « La création a donc été réalisée quand la bouche du Démiurge eut proféré les noms de tout ce qui existe. Nous avons dit plus haut l’importance du nom, qui extériorise un concept jusque-là tout mental, et qui le crée matériellement, en lui conférant une existence visible par l’écriture et audible par la voix. Avant la Création « nul Dieu n’existait encore; on ne connaissait le nom d’aucune chose »; si le Démiurge, à ce moment initial, était encore inconnu, indéfini, c’est qu’ « il n’existait point de mère pour 1ui, qui lui ait fait son nom, point de père pour lui qui l’ait émis ». Nulle chose n’existe donc avant que d’être nommée. [Inversement on tue quelqu’un en annihilant son nom, procédé employé par les magiciens.] Au papyrus de Nesmin, le Démiurge proclame : «J’ai créé toutes les formes avec ce qui est sorti de ma bouche, alors qu’il n’y avait ni ciel ni terre » – création par le Verbe, dont l’écho se retrouve dans les écrits hermétiques, la Genèse, l’évangile selon saint Jean, etc. » Pour la théorie du Verbe créateur en Égypte, voir aussi ibid., p. 439-440. « La langue opère dans tous les domaines. Nous verrons qu’elle crée les offrandes du culte funéraire (pert Icherou) et qu’elle fait « sortir » à la voix « les Dieux et les morts quand elle les appelle ». Cf. aussi A. Moret : Mystères égyptiens, Paris, nouvelle éd. 1927, p. 105 sqq. et Rituel du culte divin journalier en Égypte, Paris, 1902, p.129 sqq.2. IX, 1. Cf. aussi Ecclésiaste, XLII, 15. Ps. CVII, 20-CXLVII, 15. Isaïe, LV. 11... etc.3.Israelitisches Gebetbuch, J. Schwanthaber, Francfort-sur-1e-Main, p. 23). On sait que le premier chapitre et les quatre premiers versets ct demi du second chapitre de la Genèse (I et II, 4a) contiennent un récit de la création du monde différent de celui qui apparaît dans les chapitres suivants (Genèse, II, 4 b et sqq.). Dans la premier récit Dieu agit par sa parole (
) et dans le second il fabrique (
).
(45, for the first set of footnotes)1. De même qu’un Égyptien d’il y a 4 000 ans disait : « Toute chose qui sort de la bouche du roi se réalise sur-le-champ, car le Dieu lui a donné la connaissance de ce qui est dans les cœurs, parce qu’il est plus auguste que tout Dieu. » (Texte égyptien cité par A. Moret, op. cit., p. 229.) La théorie de Spinoza : « substantia cogitans et substantia extensa una eademque est substantia, quæ jam sub hoc, jam sub illo attributo comprehenditur. Sic etiam modus extensionis et idea illius modi una eademque est res, sed duobus modis ex pressa ; quod quidam Hebræorum quasi per nebulam vidisse videntur, qui scilicet statuunt, Deum, Dei intellectum, resque ab ipso intellectas, unum et idem esse « (Éthique, Scolie de la propos. VII du Livre II ; cf. le corollaire à la même prop. : Dei cogitandi potentia aequalis est ipsius actuali agendi potentiæ) est aussi celle de saint Thomas d’Aquin.2. Éthique, L. II., Prop. VII.(46, for the second set of footnotes)
Cependant nous savons que le mot n’est pas la chose, puisqu’il ne représente jamais ni un objet ni | une personne dans leur individualité. Le un de l’exclamation du paysan est indéfini. Ce que notre homme a voulu poser devant son esprit, c’est une menace beaucoup plus même qu’une larve de hanneton, parmi des milliers d’autres semblables à elle. Il aurait dit volontiers aussi bien : « Tiens, un machin! », ou simplement : « Tiens! » ou encore d’une façon tout à fait fruste : « Ah! » Peu importe. L’essentiel, pour lui, était de mettre en mouvement le langage. Le je de « j’ai faim » n’esi pas moi, c’est l’aspect que je manifeste de moi à ce moment-là. Ceux qui m’écoutent ignorent qui je suis, d’où je viens, quel âge j’ai, quels sentiments je nourris à leur égard, quel est mon destin. Je ne leur révèle de moi qu’une chose, ce que j’attends d’eux à ce moment-là. Le je du « cogito » cartésien n’est pas Descartes, et combien de gens le répètent sans savoir que Descartes avait pour prénom René, était tourangeau, avait fait la guerre, se méfiait des jésuites, se plaisait au commerce des femmes, etc. L’être que crée la parole, ce n’est pas un être de chair, c’est un être de raison, c’est la culpabilité de Phèdre, l’idée naissant en Fabrice qu’il aime la duchesse et qu’il doit se jeter à ses pieds, la notion de ma personnalité, la conception du vent, de la lumière, de la chaleur, en un mot tout ce qui constitue le monde intelligible.(46-47)
Il y a deux modes de l’existence. Le sentiment que nous avons de la nôtre en est un. Je doute qu’il puisse s’étendre, en tant que sentiment, riche et trouble, à d’autres existences. Je doute même qu’il soit pur de toute perception, c’est-à-dire de toute pensée et de tout langage, malgré le silence, malgré nos joies et nos angoisses que nous croyons totales. Le second est inclus dans le mot qui apporte à la pensée sa première donnée. C’est lui qui est contenu dans le « je » du « cogito » et que le « donc je suis » développe. La réalité stable, universelle, déterminée, permanente qui est l’objet de notre science, j’entends l’objet que nous examinons et qui ne fuit pas sous nos sens en même temps que le temps, c’est le langage. Les philosophes ne peuvent rien vouloir dire d’autre lorsqu’ils affirment que tout commence en nous avec la perception.(47)
From:
Parain, Brice. 1942. Recherches sur la nature et les fonctions du langage. Paris: Gallimard.
.
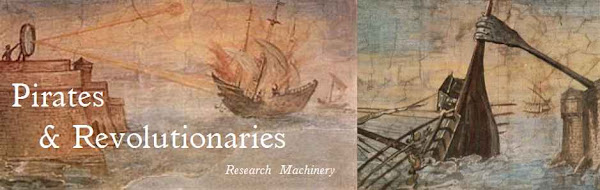

.jpeg)











































No comments:
Post a Comment